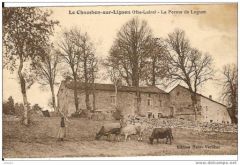
Le nom de la
ferme a-t-il donné son nom au chemin ou l’inverse ? Héritage local, le nom
est antérieur au Collège. C’est un patronyme dérivé de Luc dans le centre de la
France. Mais une vielle carte postale l’identifie comme ferme de Luguet. Erreur
typographique ? A défaut ce serait une agglutination de l’Huguet,
diminutif de Hugues...
Une ancienne ferme, donc, transformée en bâtiment d’usages administratif,
réfectoire, gymnase
et
salle de réunions. Pour nous, c’était avant tout la cantine. A environ 300
mètres des dortoirs, tout de même. L’hiver, au petit matin comme à la nuit
tombée, le sentier se pratiquait à la lampe de poche s’agitant comme autant de
lucioles, qu’il vente, pleuve ou neige. C’est dire que le porridge et le
chocolat chaud étaient avalés avec bonheur. L’hiver nous faisions des combats
d’épée avec les immenses stalactites qui descendaient du toit. Défiant
l’interdit des glissades, nous jetions les cruches d’eau dans la petite pente à
sa sortie afin d’entretenir les deux mètres de piste de glace... Seul le
déjeuner de midi était mixte. Une ségrégation prudente régnait encore aux
heures trop matines ou crépusculaires... Non-mixité qui faisait d’ailleurs
débat. Il y avait deux services. Autre ségrégation ?
Mesquinerie : 7 morceaux de viande ont disparu à Luquet :
engueulade entre maitres d’internat. Quelle abomination, en effet, quand on
songe à la perte. Confiance : on compte les élèves au repas. Il manque des
cartes de présences. Propreté : Ne pourrait-on pas avoir la joie de manger
dans une vaisselle propre ? (CFD 67, page 10, « Questions », signature
illisible)
Le réfectoire. Etait-ce bien Luc Olivier Barriol qui en était le cuisinier
?
![]() A partir de ce billet se déroule, dans un ordre à peu près
logique, la description des lieux tel qu’ils m’apparaissaient en 67/68.
Certains sont donc mentionnés comme "passés" (Les Heures Claires), d’autres
comme "en devenir" (le Gymnase). Mais tous ont leur place. Puis suivent
toutes les informations sur les élèves présents à cette période, puis ceux d’en
deçà et d’au delà.
A partir de ce billet se déroule, dans un ordre à peu près
logique, la description des lieux tel qu’ils m’apparaissaient en 67/68.
Certains sont donc mentionnés comme "passés" (Les Heures Claires), d’autres
comme "en devenir" (le Gymnase). Mais tous ont leur place. Puis suivent
toutes les informations sur les élèves présents à cette période, puis ceux d’en
deçà et d’au delà.


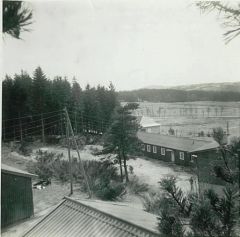
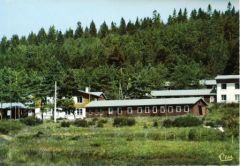

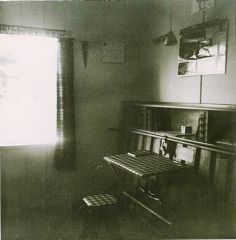





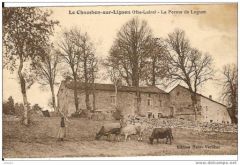


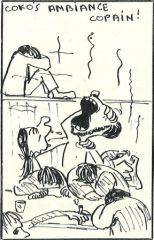
















Vos contributions
Tuesday 29 September 2015,11:37
Wednesday 9 September 2015,02:56
Wednesday 9 September 2015,02:49
Sunday 6 September 2015,16:24
Monday 17 August 2015,14:47
Monday 17 August 2015,13:20
Tuesday 7 July 2015,18:18
Tuesday 26 May 2015,22:28
Saturday 9 May 2015,07:48
Sunday 12 April 2015,19:11